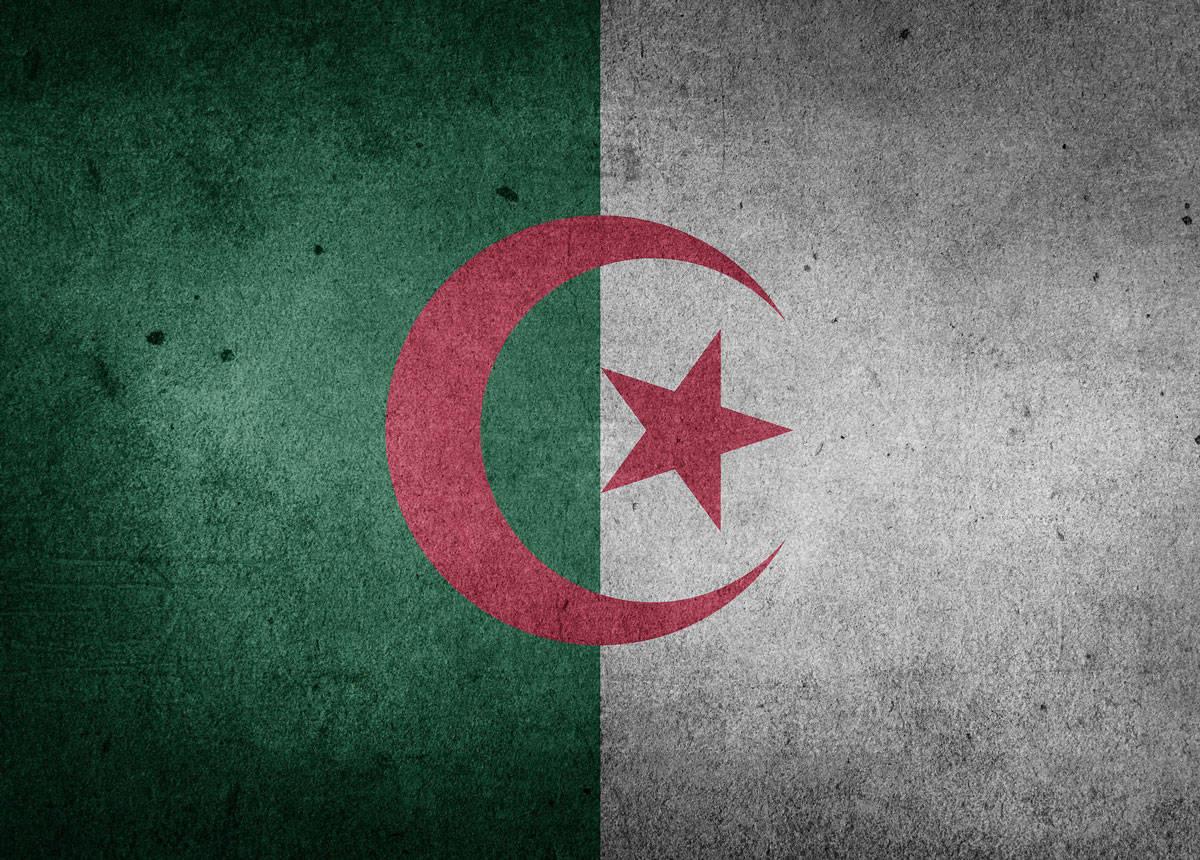Rosa Moussaoui est grand reporter à l’Humanité, elle couvre l’actualité du continent africain, du Maghreb en particulier. Pour elle, une page se tourne en Algérie, avec ce soulèvement populaire ancré dans une longue tradition de luttes démocratiques et sociales.
La situation politique en Algérie est souvent qualifiée de sclérosée, quels exemples donneriez-vous pour illustrer la situation ?
A 82 ans, le président Bouteflika est au pouvoir depuis 20 ans. Il appartient à une génération qui tient les rênes du pays depuis l’indépendance, figée dans la même vision, bloquée sur les mêmes référentiels, coupée des réalités de la société algérienne. L’Algérie est un pays très jeune : 45% de la population a moins de 25 ans. Il y a donc un incommensurable abîme, politique et générationnel, entre le peuple et les dirigeants. Avec l’insupportable sentiment que les choses ne bougent pas. Le FLN, l’ancien l’ancien parti unique, domine toujours la vie politique, avec ses alliés, et avec une partie de la mouvance islamiste “digérée” par le pouvoir. Oui, on peut donc parler d’une situation politique sclérosée. Mais la société algérienne, elle, est en mouvement.
En 2001, le soulèvement populaire allumé par l’assassinat d’un jeune , Massinissa Guermah, par des gendarmes, avait eu des effets de contagion dans le reste du pays. Les protestataires dénonçaient les violences policières commes un symptôme de l “hogra”, le mépris du pouvoir par le peuple, mais ils exprimaient aussi des revendications sociales, démocratiques. Organisé à la base, autour des comités de villages et de structures traditionnelles, les âarchs, le mouvement avait été violemment réprimé.
En 2009, le sud du pays fut le théâtre d’un mouvement social profond, durable, décidé, initié par les jeunes chômeurs de Ouargla. Dans le sud, les permis d’exploration délivrés à des compagnies étrangères en vue d’exploiter le gaz et les huiles de schiste ont également suscité d’importantes mobilisations populaires.
Et puis en 2011, dans le sillage des printemps arabes, il y a eu des manifestations innombrables, très localisées, centrées sur des revendications sociales, sur le droit au travail, au logement, à l’éducation. Plus tragique : des centaines de jeunes Algériens ont alors imité le geste d’auto-immolation de de Mohamed Bouazizi, qui avait allumé, à Sidi Bouzid, la mèche de la révolution tunisienne. Une pièce de théâtre poignante en témoigne : “End Igné”, de Mustapha Benfodil, mise en scène par Kheireddine Lardjam.
Plus récemment en 2014, le mouvement Barakat, qui exprimait le refus d’un quatrième mandat de Bouteflika et fédérait plutôt des intellectuels, des Algériens issus des classes moyennes éduquées, a été la cible d’une répression féroce. Ce qui était frappant en Algérie, avant ce soulèvement, c’était ce contraste entre une société jeune, inventive, en mouvement, et ce pouvoir figé, tenu par des hommes d’un autre temps, civils, affairistes ou militaires.
Pourquoi cette mobilisation alors qu’il semblait acquis depuis plusieurs mois que Bouteflika briguerait ce 5e mandat ?
A vrai dire, les Algériens n’y croyaient pas. Ils ne pensaient pas que les clans au pouvoir iraient jusqu’à présenter ce vieil homme impotent, dont tout le monde sait qu’il n’est pas, ou plus, le dépositaire réel du pouvoir. Les troisième et quatrième mandats de Bouteflika, déjà, ne faisaient pas consensus. Ni dans la société, ni dans l’armée, traditionnel arbitre politique depuis 1962, ni dans l’appareil d’Etat. Mais jusqu’ici, la peur de rééditer le sombre scénario de la décennie noire ou de faire sombrer le pays dans le même chaos que la Libye ou la Syrie avait entretenu une relative paralysie. Le clan Bouteflika en a joué et abusé : le vieux président a longtemps usurpé le rôle d’homme de la paix et de la stabilité.
Longtemps, l’Algérie fut traumatisé par dix années d’une guerre intérieure sans merci contre les intégristes, les insurgés islamistes. En 1988, un soulèvement de la jeunesse avait déjà fait craqué le système FLN. Conséquence, une transition démocratique avortée, avec la victoire du Front islamique du salut, l’arrêt du processus électoral et l’assassinat du populaire président Boudiaf, en 1992. Cette guerre atroce a fait des dizaines de milliers de mort. Elle a marqué la société algérienne au fer rouge. Ce trauma a eu, bien sûr, des effets politiques profonds, avec la crainte d’exposer encore le pays à la violence.
Cette page est aujourd’hui tournée. Les jeunes Algériens de 20 ans sont nés à la fin de la décennie noire ; ils n’ont connu que Bouteflika. Ils sont connectés au reste du monde, aux mutations à l’oeuvre en Afrique, en Méditerranée, dans le monde arabe. Ils ont observé, enfants, les jeunes Tunisiens renverser Ben Ali, les jeunes Burkinabè chasser Blaise Compaoré. Ils suivent de près ce qui se passe en Europe. Ils aspirent à voir leur pays se mettre au diapason du monde, de leurs rêves, de leurs aspirations. Cet élan n’est pas sans lien avec la contestation, partout dans le monde, d’un système néolibéral prêt à affirmer partout ses penchants autoritaires. Les années Bouteflika furent aussi celles de la libéralisation, des privatisations, de l’argent sale et de la corruption liée au détournement de la rente pétrolière et à l’attribution des marchés publics. En Algérie, ça ne passe pas : il y a un courant égalitaire très ancien, très profond, sans doute lié à la résistance au colonialisme. L’attachement aux principes de liberté et de justice sociale est profond. Or le pouvoir a troqué depuis longtemps ces principes contre une redistribution relative et clientéliste de la rente pétrolière, pour tenter d’acheter une paix sociale précaire. Les Algériens n’en ont jamais été dupes. La jeune génération se réclame explicitement des idéaux portés par les combattants de la guerre de libération, qui défendaient le projet d’une République sociale et démocratique. Cet idéal, cet esprit révolutionnaire qui irrigue l’histoire de l’Algérie rejaillit aujourd’hui.
La jeunesse semble occuper une place particulière dans cette mobilisation, subit-elle davantage le marasme économique de l’Algérie ?
Evidemment. Le problème numéro 1 de l’Algérie, c’est le chômage de masse des jeunes. La jeunesse a accédé massivement à l’éducation, à l’enseignement supérieur : elle est formée mais ne trouve aucun débouché. En fait, l’économie de l’Algérie est ultra dépendante des hydrocarbures. Elle exporte des hydrocarbures et importe quasiment tout ce qu’elle consomme, puisqu’il n’y a pas de base industrielle sérieuse. La croissance des années 2000 était un peu factice puisque tirée par les prix élevées des hydrocarbures : elle n’a créé que très peu d’emplois. En 2014, la chute brutale des cours des hydrocarbures sur le marché mondial a eu des conséquences très graves sur l’économie algérienne. Les contrecoups de ce choc se font sentir aujourd’hui, avec une baisse importante du pouvoir d’achat des Algériens les plus modestes et même des classes moyennes.La politique de redistribution clientéliste s’est rétractée, créant des frustrations sociales qui ne sont pas étrangères au ras-le-bol qu’exprime aujourd’hui la société algérienne.
Dans tous les mouvements sociaux, démocratiques depuis l’indépendance, la jeunesse s’est trouvée aux avants-postes. Tout simplement parce que c’est un pays très jeune. Aujourd’hui encore, la jeunesse est le carburant de ce mouvement. Elle est mobilisée dans toute sa diversité : étudiants, chômeurs, jeunes actifs, supporters de foot. Ces “ultras” ont joué un rôle crucial pour maintenir la flamme de la contestation politique et reconquérir l’espace public, des stades à la rue.
Pourquoi les manifestants insistent-ils tant sur le caractère pacifique de leur mobilisation ?
L’histoire contemporaine de l’Algérie est marquée par la violence. Celle de la guerre d’indépendance, celle du régime contre la société. En 1988, l’armée a fait feu sur les jeunes protestataires. Bilan : peut être 800 morts. En 2001, la répression en Kabylie a fait 127 morts et 5000 blessés. On comprend mieux, dans ces conditions, la portée du slogan “Pouvoir assassin”. Le bilan de la décennie noire n’est pas exactement connu : il est, quoi qu’il en soit, épouvantable. La société algérienne est écoeurée de cette violence. Elle veut fermer, enfin, cette longue parenthèse du sang. Le choix du pacifisme tient aussi à la volonté de déjouer les manoeuvres du pouvoir. “L’Algérie n’est ni la Libye, ni la Syrie”, répondent les manifestants aux responsables politiques et militaires qui les accusent de vouloir entraîner le pays sur des pentes dangereuses. Il est hors de question, pour ceux qui protestent, d’offrir le moindre prétexte au basculement dans la violence, la moindre justification à la répression. Ce mot d’ordre de “Silmya”, “pacifisme”, n’est d’ailleurs pas nouveau. Il était scandé les manifestations à Al Hoceima ou Nador, au Maroc, il y a deux ans, lors du soulèvement populaire qui a secoué le Rif après la mort de Moucine Fikri, un jeune marchand de poisson broyé par une benne à ordure en tentant de récupérer sa marchandise jetée là par des policiers.
Les annonces figurant dans la lettre de Bouteflika sont-elles de nature à calmer les Algériens ?
Le système fait le choix du passage en force. Il reste sourd à ce mouvement historique qui se déploie, fait inédit, sur tout le territoire, d’Alger à Adrar, d’Oran à Annaba. Ils choisissent de mépriser l’expression du peuple en proposant des expédients, en présentant ce candidat qui n’a pas les facultés physiques d’exercer un mandat présidentiel. Une fois la mascarade électorale passé, jurent-ils, nous organiserons une conférence où tout le monde sera convié, où nous pourrons discuter. Mais discuter de quoi, lorsque même la simple exigence d’une représentation digne et de décente de l’Algérie est écartée d’un revers de main ?
Cette proposition ridicule est vécu comme une provocation. A l’annonce du dépôt de la candidature de Bouteflika, des manifestations nocturnes massives ont eu lieu dans tout le pays. Étudiants, enseignants, avocats, médecins, journalistes descendent dans les rues. Des sections syndicales se joignent à la contestation et se démarquent de la très servile direction de la centrale UGTA. Ce mouvement n’a cessé de gagner en ampleur, en puissance, en enracinement depuis le 22 février. Les Algériens et les Algériennes semblent déterminés à aller jusqu’au bout pour reprendre leur destin en main.
L’opposition semble faible et éclatée, les clans au pouvoir semblent à l’inverse unis par leur désir commun du maintien du statu quo, quelles issues politiques sont envisageables ?
Le pouvoir n’est pas uni derrière un statu quo. Des lignes de fractures apparaissent, les défections se succèdent à un rythme effréné. C’en est même suspect… La candidature de Bouteflika ne fait pas l’unanimité. Ni dans l’appareil d’Etat, ni dans l’armée, qui est loin d’être un monolithe.
S’agissant de l’opposition, elle n’est pas un seul et même corps politique. Il y a des oppositions : les islamistes, en partie digérés par le pouvoir, même si le mouvement Rachad, héritier du Front islamique du salut (FIS), essaye de s’agiter ; les repentis, issus du système, dont certains ont occupé de hautes fonctions, comme l’ancien Premier ministre Ali Benflis ; l’opposition traditionnelle, des laïcs du RCD aux socialistes du FFS. Et puis il existe, en Algérie, une opposition de gauche, courageuse, obstinée malgré les coups qu’elle a pris, les militants assassinés ou exilés durant la décennie noire, la censure et l’invisibilisation. Cette opposition là est certes affaiblie, éclatée, mais elle existe, elle se bat. Heureusement qu’elle a entretenu, dans des conditions éprouvantes, la flamme de la revendication démocratique, égalitaire. Je suis convaincue que de nouvelles figures émergeront de ce côté, qu’on assistera bientôt au retour du clivage gauche-droite, dans un pays où la vie politique s’est structurée depuis le début des années 90 autour des polarités laïcs/islamistes. Une nouvelle scène politique est en train de prendre forme.
La diaspora algérienne est également fortement mobilisée en France, comment l’expliquez-vous ?
La diaspora algérienne a toujours joué un rôle politique très important. C’est en France, dans l’immigration, qu’est née la première organisation indépendantiste : l’Etoile nord-africaine. Cette diaspora n’a jamais cessé d’agir, de s’exprimer. Elle reste très connectée à ce qui se passe en Algérie, très sensible aux secousses qui refaçonnent le pays. Elle ne pouvait donc pas rester de marbre face à un mouvement populaire comme celui-ci. Sur la place de la République, à Paris, mais aussi à Marseille, à Toulouse et ailleurs, d’impressionnants rassemblements ont lieu chaque semaine, en solidarité avec ceux qui occupent la rue en Algérie. Dans cette mobilisation : beaucoup de binationaux, des héritiers de l’immigration algérienne qui s’intéressent naturellement au devenir d’un pays auquel ils sont très attachés. Il sont nombreux, d’ailleurs, à se rendre ces jours-ci en Algérie pour vivre là-bas ce moment historique.